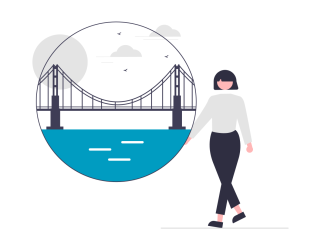L’urgence ne dispense pas d’un minimum de mise en concurrence. C’est sans doute ce que retiendra ce maire mis en examen pour ne pas avoir respecté le code des marchés publics. Il est condamné dans le même temps pour favoritisme dans une affaire concernant l’OPHLM qu’il présidait.
Les faits
Un pont propriété de l’Etat devenait dangereux pour la circulation en raison de son état de vétusté. L’Etat, qui n’avait pas les moyens de le réparer, a vu d’un bon oeil la construction dans l’urgence d’un nouveau pont par la ville.
D’où un contrôle de la légalité jugé bien distant par le juge d’instruction qui, ne souhaitant pas faire porter le chapeau aux seuls maire et au DST poursuivis, rend une ordonnance de non lieu général. Tel n’est pas l’avis de la chambre de l’instruction qui renvoie les mis en examen en correctionnelle. Relaxé en première instance, le maire est condamné en appel à 10 000 euros d’amende par la Cour d’appel de Montpellier ce que confirme la Cour de cassation (le DST avait été en revanche définitivement blanchi).
Il faut dire que parallèlement à ce marché pour la construction du pont, le maire était également poursuivi pour favoritisme en sa qualité de président d’un OPHLM s’agissant de la rénovation d’un ensemble immobilier.
Il n’en demeure pas moins que la condamnation du maire pour la construction du pont laisse un goût amer d’inachevé tant l’analyse des faits démontre que la ville a agi en étroite liaison avec les services de la Préfecture.
Le contrôle de la chambre régionale des comptes
Le 30 juin 1995, la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon dénonce au procureur de la République les conditions irrégulières dans lesquelles a été attribué le marché public pour la construction d’un pont (pour un montant de 8,5 millions de francs) par une ville méditerranéenne.
Les faits révélés à l’occasion du contrôle portent sur les exercices 1988 à 1992. Courant 1989, la ville décide de lancer un concours pour la réalisation d’un tunnel afin d’améliorer la circulation dans la ville. Dans leur rapport devant la CAO, les services techniques de la ville après avoir constaté qu’aucune proposition n’était satisfaisante en l’état, proposent de déclarer le marché infructueux et de continuer à négocier avec la société dont la proposition apparaît la meilleure. Cette proposition est retenue par la CAO mais le projet est finalement ajourné faute pour la collectivité locale de capacités financières suffisantes pour une opération estimée à plus de 100 millions de francs. Les négociations n’en continuent pas moins durant l’année 1990 avant que la ville ne renonce définitivement, début 1991, au projet. Des solutions alternatives moins onéreuses sont alors étudiées en partenariat avec les services de la préfecture et la Région. C’est dans ce contexte qu’en octobre 1992 un rapport du CETE (Centre d’études techniques de l’équipement) attire de nouveau (après un premier rapport rendu en 1988) l’attention des services de l’Etat sur la dangerosité et la vétusté d’un pont mobile.
Les travaux de réparation sont estimés à 6 millions de francs. Il est préconisé la limitation du tonnage des véhicules empruntant le pont en attendant la réalisation de travaux. Le préfet demande alors au maire d’interdire la circulation sur le pont. Une réunion est organisée à la préfecture au cours de laquelle est mise en exergue l’urgence de la situation, la circulation dans la ville devenant ingérable.
Il est en conséquence décidé de construire un nouveau pont dans de brefs délais, en tout état de cause avant la période estivale et l’arrivée des touristes. La direction des services techniques propose pour répondre à cet impératif de rapidité, de rattacher la construction de ce pont au premier concours lancé en 1989 qui prévoit en annexe du tunnel la construction d’un pont sur le canal. Le 3 février 1993, le conseil municipal autorise le maire à passer un marché négocié avec l’entreprise initialement pressentie pour un montant de 8,5 millions de Francs. Les délais convenus avec la préfecture sont tenus puisque le pont est achevé à la mi-juillet 1993.
Les griefs retenus
La chambre régionale des comptes conteste ce choix :
– le délai était suffisant pour organiser une mise en compétition en bonne et due forme (procédure d’appel d’offres avec concours ou à tout le moins, à supposer établie l’urgence qu’elle invoque, à se dispenser d’une mise en compétition par une consultation écrite, au moins sommaire, conformément à l’article 308 du Code des marchés publics alors applicable) ;
– la référence à l’infructuosité du marché initial n’est pas pertinente dès lors que les deux opérations étaient radicalement différentes ;
– certaines des offres des entreprises ayant répondu au concours organisé en 1989 incluaient également en annexe un projet de pont à des tarifs moins chers que ceux présentés par la société retenue ;
– enfin l’actualisation des prix pratiqués par rapport à l’offre initiale (majoration de plus de 2 millions de francs) n’apparaissait pas justifiées dans leur totalité.
Les motifs du non lieu
Le juge retient deux charges avant de finalement prononcer un non-lieu.
> le non-respect des règles de mise en concurrence préalable
Pour le juge d’instruction “l’urgence n’est guère discutable puisqu’il avait été décidé, au cours de la réunion tenue à la préfecture le 10 décembre 1992, que le pont devait être construit avant ou au début de l’été 1993”.
6 mois pour passer ce marché, c’est court. Mais cela n’exonère pas la commune de respecter les règles de mise en concurrence préalable (anciens articles 103 et 104 du code des marchés publics). C’est en ce sens que le magistrat instructeur en conclut que la procédure “est entachée d’irrégularités et contraire aux prescriptions légales”
> l’entreprise jugée la meilleure en 1989 ne présentait plus les mêmes avantages en 1993
Le juge d’instruction se demande si l’attribution du marché a procuré un avantage injustifié à l’entreprise retenue. Certes en 1989, elle présentait des atouts en terme de tarif, sur les plans techniques et esthétiques. La différence de prix quatre ans plus tard est justifiée par les modifications apportées au projet initial et donc aux coûts inhérents à ces modifications (frais généraux d’installation du chantier, augmentation de 30 % des parois moulées, de 45 % des volumes des merlons, garde corps exigés par l’architecte des bâtiments de France...).
Mais étant donné justement les différences entre les deux projets, la Ville ne pouvait pas se référer au premier marché pour justifier le recours au marché négocié sans publicité et mise en concurrence préalable.
Le juge d’instruction précise enfin que “familiarisé avec la réglementation en vigueur, le maire ne saurait soutenir qu’il n’a pas, en l’occurrence, eu connaissance que la procédure adoptée violait la loi d’attribution des marchés publics” ? Pourtant le maire ne peut pas porter l’entière responsabilité car :
> la décision de construction du pont a été prise au cours de la réunion préfectorale ;
> la proposition de rattacher le marché au marché initial de 1989 a été faite par le directeur des services techniques ;
> c’est sur le rapport de l’adjoint à l’urbanisme, décédé entre-temps, que le conseil municipal a adopté le marché négocié.
Considérant qu’à aucun moment, il n’a été établi un fait de corruption ou tentative de corruption en direction des élus ou des services municipaux”, le juge estime que c’est « l’attitude de l’administration dans la conduite de ce dossier qui, à maints égards, parait critiquable » :
– dès 1988 le CETE avait alerté les autorités sur le mauvais état du pont dans un rapport resté sans effet ;
– la préfecture n’a réagi qu’à la lecture du second rapport de 1992 qui constatait une aggravation de l’état de l’ouvrage ;
– c’est encore la préfecture qui prenait l’initiative de la réunion au cours de laquelle était décidée la construction d’un nouveau pont, ce qui arrangeait financièrement l’Etat propriétaire du pont défectueux ;
– il était dans ces conditions difficile pour la préfecture d’exercer son contrôle de la légalité.
De fait “en omettant d’exercer sa censure à l’égard d’un marché entaché d’irrégularité, la Préfecture n’a pas joué son rôle et laisser accréditer l’idée d’un consensus avec la ville dans la réalisation du projet de pont et ce d’autant plus que le pont de la Victoire, en mauvais état, était la propriété de l’Etat et non de la ville”. Et le juge de conclure que “la volonté de construire rapidement ce pont ayant conduit les autorités administratives à pousser la municipalité à adopter une procédure quelque peu expéditive, force est de reconnaître que l’on ne saurait, sans iniquité, en faire retomber la responsabilité pénale sur les seuls édiles”.
Telle ne sera pas la position de la Cour de cassation qui approuve la condamnation du maire prononcée par les juges d’appel.
Les motifs de condamnation
Le maire est bien intervenu dans la prise de décision puisqu’il “résulte du registre des délibérations du conseil municipal qu’il a présidé la séance du 3 février 1993, au cours de laquelle il a été décidé de conclure le marché litigieux” ;
– “l’urgence de conclure le marché litigieux n’est pas caractérisée dès lors que la nécessité de construire un nouveau pont avait été évoquée dès 1988, puis rappelée en octobre 1992 et, qu’en toute hypothèse, la municipalité aurait eu la possibilité de procéder à un appel d’offres dans le cadre de la procédure d’urgence ou, à tout le moins, à une consultation écrite sommaire entre le 10 décembre 1992, date à laquelle la décision d’édifier un pont a été arrêtée, et la signature du marché” ;
– “le dossier du marché négocié ne faisait pas état du critère de technicité et qu’il n’est pas établi que le pont ne pouvait être construit qu’en ayant recours au brevet "Porthos" dont était titulaire l’entreprise attributaire” peu important à cet égard que le brevet en question “ait reçu l’accord de l’architecte des bâtiments de France et de la commission des sites, l’exigence de recourir à ce brevet n’étant pas mentionnée dans les besoins du marché”.
Quant aux scrupules du juge d’instruction qui trouvait inéquitable de condamner le seul élu pour la construction d’un pont qui d’abord arrangé l’Etat, ils n’ont manifestement pas troublé les magistrats d’appel et de cassation.
Offres multiples et substitution de sous-traitants
Début 1993, un office public d’HLM, présidé par le même maire, lance une procédure d’appel d’offres pour la rénovation d’un ensemble immobilier sur une presqu’île. Lors de la réunion de la Commission d’appel d’offres (CAO) il est précisé que l’enveloppe globale de l’opération est portée de 33 800 000 francs à 34 350 000 francs permettant ainsi l’incorporation de variantes de conforts proposées par les entreprises.
En novembre 1993, la CAO attribue le marché à l’entreprise moins disante malgré les réserves du représentant de la DGCCRF objectant que deux sociétés, dont la société attributaire, ont soumis deux actes d’engagement, dont le montant varie d’un million et demi de francs en fonction du choix du sous-traitant pour le lot "menuiserie" (la société retenue est classée première et quatrième selon le sous-traitant).
A l’issue de la séance de la CAO, le maire demande à ce que soit spécifié que l’entreprise adjudicataire puisse modifier le cas échéant de sous-traitant à condition de rester dans l’enveloppe financière. Faculté dont profite la société retenue dès sa désignation. Les travaux sont livrés fin 1995.
Entre temps, en mai 1994, le marché est déferré devant le tribunal administratif qui l’annule le 6 mars 1996 en relevant que l’entreprise attributaire a présenté deux offres distinctes de surcroît non conforme au cahier des charges.
Parallèlement, deux ans après l’attribution du marché, la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés (MIEM) dénonce au procureur de la République trois irrégularités :
> le report de la date de dépôt des offres a été notifié aux seules entreprises ayant retiré un dossier rompant ainsi l’égalité avec d’autres candidats potentiels ;
> le registre spécial d’enregistrement des offres n’a pas été tenu ;
> les offres des deux entreprises ayant soumis deux actes d’engagement auraient dues être écartées.
Mis en examen le maire déclare être passé outre les réserves du représentant de la DGCCRF ayant appris que le fonctionnaire n’était autre que... le frère du directeur de l’entreprise classée troisième !
Le 20 mars 2001, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu. Les violations des dispositions du code des marchés publics ont été très bénéfiques économiquement à l’OPHLM (le sous-traitant retenu a du consentir de tels rabais qu’il a fait faillite après !), et il n’est pas démontré que l’élu, qui s’est reposé sur les compétences professionnelles du directeur de l’office, “ait eu connaissance personnellement de la violation des textes”.
Sur appel du parquet cette ordonnance est infirmée et le maire renvoyé en correctionnelle. Relaxé en première instance, la Cour de cassation confirme sa condamnation en appel dans l’arrêt du 14 décembre 2005. Le fait d’avoir permis à la société attributaire de présenter "deux actes d’engagement et deux prix différents avec deux sous-traitants distincts", ce d’autant plus que “les actes d’engagement transmis en préfecture ont été élaborés postérieurement à la date de dépôt des offres qui y figure et ont été "adaptés" aux résultats de la consultation” constitue une rupture d’égalité entre les candidats. Le maire est bien responsable dès lors, selon le directeur de l’office, qu’il présidait de manière effective et entière les CAO et “qu’informé des réserves émises par le représentant de la DGCCRF, il a refusé toute discussion sur les problèmes soulevés”. N’est finalement pas retenu à charge le report du délai des offres, l’accusation n’ayant pas démontré que l’élu en avait eu connaissance.