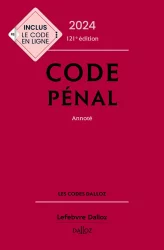Délits non intentionnels : de la réception « territoriale »
des dérogations relatives aux poursuites

Université Paris-Panthéon-Assas
La réforme du code pénal vient d’atteindre ses trente années d’existence, et nous savons la place importante qu’elle occupe en rapport avec les collectivités territoriales, résultat d’une subtile combinaison entre la responsabilité pénale des personnes morales et la conception des délits non intentionnels. La matière est immense, qui s’est enrichie non seulement d’applications nombreuses et variées, mais encore de plusieurs interventions ponctuelles du législateur pour en améliorer les données.
Ce n’est pas dans son contenu substantiel que nous allons la présenter, mais dans sa dimension formelle, en nous attachant à l’action publique destinée à la rendre opérationnelle. Cette action est le prolongement processuel de l’infraction, avec pour finalité de réagir à sa commission, l’application du droit pénal n’étant pas séparable de ce qu’elle assure d’indispensable vers la reconnaissance et l’engagement de la responsabilité. Elle emprunte à des données classiques, mais aussi à des dispositions particulières, qui doivent leur existence à ce que l’homicide et les violences involontaires présentent de nature suffisamment originale pour les justifier.
C’est en rapport avec ces spécificités que nous allons progresser, en termes, d’abord de compétence (I), ensuite de procédure (II).
I – La compétence
La compétence matérielle ne soulève aucune difficulté, toutes les infractions non intentionnelles étant des délits, ce qui renvoie aux juridictions correctionnelles pour en connaître. En revanche, la compétence territoriale est sujette à quelques variations, générées par la délocalisation de certains contentieux, ou par leur spécialisation.
A – La délocalisation
Le code de procédure pénale contenait des dispositions destinées à éviter que les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires fussent de la compétence des juridictions dans le ressort territorial desquelles ces personnes exerçaient ou avaient exercé leurs missions (c. pr. pén., ancien art. 679). Les décideurs locaux ont ensuite rejoint ce dispositif par la loi n° 74-646 du 18 juillet 1974 relative à la mise en cause pénale des maires et modifiant les articles 681 et suivants du code de procédure pénale. Il en résultait que, lorsqu’un maire, ou l’élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d’une délégation spéciale, étaient susceptibles d’être inculpés d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présentait, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuait comme en matière de règlement de juges et désignait la chambre d’accusation qui pouvait être chargée de l’instruction. Et si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constituait un délit, il était renvoyé devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle il exerçait ses fonctions.
Mais, sur des considérations égalitaires, cette technique, dite « privilèges de juridiction », a été abrogée par la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, alors que la délocalisation qui en résultait n’avait pas que des inconvénients, loin de là. Il n’est pas de bonne politique, en effet, que des élus ou responsables locaux soient soumis au jugement de magistrats qu’ils côtoient régulièrement, soit dans le cadre de leurs fonctions, soit au titre de manifestations officielles ou mondaines, et nombre d’affaires en témoignent, qui ont manqué de sérénité du fait de cette situation regrettable. Le législateur en est finalement convenu, qui a exercé un repentir actif par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, laquelle a renoué, sinon avec la procédure antérieure, du moins avec l’idée d’un déplacement des affaires locales, afin de ne rien perdre du crédit attaché à la justice.
Est en cause l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, plusieurs fois amendé et compété depuis sa création. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République, et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel. Et si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître de l’affaire, étant précisé que la décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le principe de ce dépaysement est sain, y compris pour les délits non intentionnels, qui n’en sont pas exclus. Certes, les contentieux correspondants n’ont pas la même sensibilité que ceux procédant d’infractions intentionnelles, et la différence ne peut que s’en ressentir sur l’opportunité d’une telle délocalisation. Mais il convient de ne pas négliger ce que, en rapport avec de graves fautes de gestion, ou en relation avec de nombreuses victimes, certaines affaires peuvent drainer d’émotions localement partagées, et donc de risques accrus au regard de l’exigence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties. C’est pourquoi, on ne peut qu’approuver le retour à cet instrument de transparence judiciaire.
B – La spécialisation
La tendance est aujourd’hui très prononcée consistant dans la spécialisation de certaines juridictions pour connaître de plusieurs familles d’infractions, de sorte que la compétence qui leur est dévolue rejoint ce que les crimes ou les délits visés emportent de spécificités. Les homicides involontaires et les violences involontaires sont directement concernés au titre des accidents dits « collectifs ».
A ces accidents correspondent des évènements à l’origine de dommages corporels ou matériels à l’égard de nombreuses victimes, qui ont pour origine ou pour facteur contributif une intervention humaine susceptible de recevoir une qualification pénale. La finalité est répressive, avec pour enjeu de confier les poursuites à des formations spécialisées, afin d’asseoir une compétence parfaitement adaptée à ce qu’imposent des faits qui sortent de l’ordinaire. Les homicides involontaires et les violences involontaires sont bien-sûr au cœur du dispositif, depuis que la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures correctionnelles a complété le code de procédure pénale en ce sens, par une division précisément consacrée à la « procédure applicable en cas d’accident collectif », composée des articles 706-176 à 706-182.
L’article 706-176 du code de procédure pénale retient la compétence en ces termes : « La compétence territoriale d’un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d’une grande complexité (al. 1er) – Cette compétence s’étend aux infractions connexes (al. 2) – Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions (al. 3) ». On le voit, la solution consiste en une régionalisation ou inter-régionalisation des juridictions concernées, sur un principe de compétence concurrente à celle découlant du droit commun. La dimension collective des accidents impose cette solution, qui évite un émiettement des actions et de leur dénouement, avec un profit sensible pour tout le monde, tant pour la justice, bénéficiaire d’un recentrage fort opérationnel, que pour les personnes engagées dans les contentieux, qui ne peuvent que trouver une défense à la hauteur de leurs intérêts communs.
Il va de soi que les décideurs locaux sont tributaires de cette spécialisation, même si elle ne leur est pas réservée. Il en résulte une possibilité de « déplacement » ou de « délocalisation » toutes les fois que, par leur comportement, ils sont à l’origine de véritables catastrophes, en considération du nombre de victimes atteintes ou de circonstances particulièrement difficiles à dénouer. Le critère est quantitatif, non qualitatif. N’est pas en cause la gravité des fautes commises, en termes de faute ordinaire ou de faute qualifiée, elle-même répartie entre la faute délibérée et la faute caractérisée. La causalité est pareillement hors sujet, selon qu’elle est directe ou indirecte, sauf à réserver, dans la décision sur le fond, au seul bénéfice des personnes physiques, et donc à l’exclusion de la collectivité territoriale prise en sa qualité de personne morale, la dépénalisation de la faute simple indirecte opérée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Dérogeant à la compétence ordinaire des juridictions répressives, l’article 706-176 du code de procédure pénale est d’interprétation stricte, ce qui explique que soient déclinées avec précision les infractions entrant dans le champ de l’exception. Tous les délits non intentionnels ne sont pas concernés : seuls le sont l’homicide involontaire, les violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, et les violences involontaires commises par une faute délibérée avec pour résultat une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, ces qualifications étant doublement retenues, et dans leur version générale, et dans leur version spéciale en rapport avec la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. En fait, sont visés les délits correspondant à des schémas plausibles d’accidents collectifs, ce que ne sont pas les homicides et atteintes involontaires qui résultent d’agressions commises par des chiens (c. pén., art. 221-6-2 et 222-19-2), lesquels sont exclus du système. La sélection est logique, pour reproduire la sociologie du collectif, et y répondre sur le plan processuel.
La compétence ainsi dévolue aux juridictions spécialisées est une compétence concurrente, ce qui ressort explicitement de l’article 706-178 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire mentionnés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42 du code de procédure pénale ». C’est dire que le système ne consiste pas à priver d’emblée les juridictions normalement compétentes de leur vocation à connaître des faits, et que reste entière la compétence territoriale de droit commun du procureur de la République pour recevoir les plaintes et dénonciations et apprécier les suites à leur donner (c. pr. pén., art. 43), celle du juge d’instruction chargé de procéder aux informations dont il est requis (c. pr. pén., art. 52), celle du tribunal correctionnel pour connaître des délits (c. pr. pén., art. 382), et enfin celle en lien avec la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par les personnes morales (c. pr. pén., art. 706-42). L’ordinaire n’est donc pas exclu, restant parfaitement applicable.
Enfin, et contrairement à la délocalisation proprement dite, le transfert de compétence n’est pas ici un simple acte d’administration judiciaire. Il procède d’une véritable décision, parée de toutes les garanties et du respect des droits qui vont avec. La précision est importante, qui témoigne des enjeux liés à la spécialisation, laquelle ne doit pas être perçue comme une mesure neutre pour les parties au procès. La compétence d’une juridiction n’est jamais neutre, surtout dans un contexte d’infractions en séries, surtout attentatoires à la vie ou à l’intégrité des personnes. C’est pourquoi le préalable d’une telle compétence mérite d’être retenu en termes contentieux.
II – La procédure
Même non intentionnelles, les atteintes aux personnes comptent parmi les plus redoutables dans la hiérarchie des valeurs sociales, à la mesure du plan du code pénal, qui en traite prioritairement dans le livre II. Cette dimension « personnelle » de l’infraction interdit certaines facilités, telles que le code de procédure pénale les contient, destinées, soit à contourner les poursuites par des solutions alternatives, soit, une fois celles-ci engagées, à les soumettre à des modalités simplifiées de saisine ou de jugement. Les délits non intentionnels font donc figure d’exceptions, dans des conditions qu’il convient de préciser, la matière relevant d’une approche stricte, au nom de la légalité qui préside à sa conception.
A – Les procédures alternatives
Il est un principe majeur en procédure pénale, énoncé à l’article 40 du code de procédure pénale, celui de l’opportunité des poursuites : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner […] » (al. 1er). La plainte reposerait-elle sur des faits incontestables, des poursuites peuvent ne pas être exercées pour autant. Ce qui explique que nombre de plaintes ou de dénonciations n’ont jamais aucune suite, du moins n’ont pas la suite que peuvent espérer les victimes, avec pour conséquence de leur faire préférer la constitution de partie civile, voire la citation directe.
L’article 40-1 du code de procédure pénale décline les options dont dispose le procureur de la République. Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, il décide s’il est opportun : soit d’engager des poursuites ; soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Une plainte n’a donc pas pour aboutissement obligé l’engagement d’une poursuite par la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, elle peut également se solder par une procédure alternative ou un classement sans suite. Le procureur de la République dispose ainsi d’une prérogative importante, qui s’apparente à un pouvoir d’individualisation dans l’orientation de l’affaire soumise à son appréciation.
L’alternative aux poursuites est elle-même sujette à trois opportunités. Remontant à la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, avec d’importants compléments issus de plusieurs lois postérieures, il s’agit d’une série de mesures destinées à « monnayer » l’absence des poursuites, applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales, soit communément, soit exclusivement. Les articles 41-1, 41-1-2, 41-1-3 et 41-2 du code de procédure pénale sont en cause, mais aussi les articles 41-3 et 41-3-1 A, qui procèdent à des extensions de leurs domaines respectifs. Plus concrètement, sont concernées les différentes obligations réparatrices et de reclassement pouvant être imposées à l’auteur de l’infraction par le procureur de la République préalablement à sa décision sur l’action publique (c. pr. pén., art. 41-1), la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) applicable aux seules personnes morales (c. pr. pén., art. 41-1-2 et art. 41-1-3), et la composition pénale (c. pr. pén., art. 41-2).
Les délits non intentionnels sont bien sûr affectés, mais avec d’importantes réserves, d’abord relatives à la convention judiciaire d’intérêt public, ensuite relatives à la composition pénale.
1/ La convention judiciaire d’intérêt public
Prévus au livre II du code pénal, les crimes et délits contre les personnes sont exclus de la convention judiciaire d’intérêt public, exclusion implicite dans l’article 41-1-2 (CJIP relative à la probité et à la fiscalité), et explicite dans l’article 41-1-3 (CJIP relative à l’environnement). Il s’en déduit que, prises en leur qualité de personnes morales, les collectivités territoriales à même d’engager leur responsabilité pénale ne sauraient se voir proposer une telle convention. La solution est pertinente, liée qu’elle est à une incompatibilité politique entre l’« arrangement » consensuel dont procède la convention et ce qui est relatif à des dommages corporels, seraient-ils non intentionnels. Autant une convention judiciaire d’intérêt public peut se comprendre dans un contexte purement financier ou matériel, autant la justice ne saurait passer par un tel mécanisme en rapport avec une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
2/ La composition pénale
Il en est de même de la composition pénale pouvant être proposée aux personnes physiques, et donc aux élus territoriaux dont la responsabilité serait en cause. En application de l’article 41-2 du code de procédure pénale, elle n’est pas applicable « en matière […] de délits d’homicides involontaires […] ». Là encore l’exclusion se justifie par la gravité du dommage, puisqu’il s’agit de la mort de la victime, avec pour conséquence de ne pouvoir se satisfaire d’un défaut de poursuites, et ce malgré le caractère non intentionnel de l’infraction. Un procès s’impose, avec tout ce qu’il emporte de débats, d’appréciations contradictoires, et de décisions à la hauteur des circonstances, les atteintes mortelles aux personnes ne pouvant qu’être étrangères à des procédures dont l’objet est de gagner du temps, ou d’économiser les moyens de la justice.
Seuls sont visés les homicides, non les violences involontaires, et, parce que l’article 41-2 est d’interprétation stricte, ses dispositions ne sauraient être étendues auxdites violences, qui restent dans son champ d’application, et peuvent donc être l’objet d’une composition pénale, à supposer, bien sûr, que toutes les conditions en soient remplies. La différence se comprend : situé au sommet des atteintes à la personne, l’homicide ne saurait échapper aux procédures classiques, mais de « simples » atteintes corporelles ou psychiques peuvent se concevoir hors de ces procédures, d’autant plus que l’alternative passe en principe par la saisine du président du tribunal judiciaire, et qu’elle est tributaire d’une ordonnance de validation, ce qui la soumet à un contrôle d’opportunité non négligeable. Il est vrai que la proposition de composition peut échapper à cette validation lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de
composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, c’est-à-dire le montant maximum de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe en récidive, à savoir 3 000 € (art. 41-2, al. 29). Mais, outre le fait que ces figures correspondent aux violences les moins graves, il appartient au procureur de la République de proposer un montant adapté s’il entend recourir à la compétence du magistrat du siège.
On le voit, la matière est faite de nuances, de nuances qui ne peuvent que favoriser des réponses adaptées à la situation des élus locaux et des collectivités territoriales. Parce qu’elles évitent l’action publique, les alternatives aux poursuites ne peuvent que s’intégrer dans une politique compatible avec le respect dû aux personnes, les atteintes qu’elles auraient subies ne seraient-elles qu’involontaires. La conséquence est importante, qui maintient les responsables, personnes physiques et personnes morales, dans le droit commun de la répression.
B – Les procédures simplifiées
Une fois les poursuites engagées, la procédure suit son cours selon des règles variables, le législateur ayant pour préoccupation de les diversifier en fonction de la gravité ou de la complexité des affaires. L’uniformité ne servirait à rien, tant les espèces présentent des différences, avec des besoins à couvrir qui ne sont pas les mêmes, en investigations, en débats contradictoires, en collégialité des juridictions compétentes, et seule la diversité est à même d’assurer de justes réponses, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui veille à ce que ne soient pas pour autant sacrifiés les droits fondamentaux du procès pénal. Ces adaptations passent notamment par des modalités simplifiées, autrement dit des versions allégées par rapport au droit commun, la finalité étant d’échapper à tout ce qui pèserait trop lourdement des règles normalement applicables, faute d’adéquation au type de contentieux concerné, ou à la poursuite des faits qui en sont l’objet.
Les délits d’homicide involontaire et de violences involontaires doivent être situés par rapport à ces dérogations. La problématique est simple, conforme à ce que nous en savons déjà : parce que ces infractions sont attentatoires à la personne, allant jusqu’à provoquer la mort, il est normal de ne pas verser dans une simplification qui reviendrait à consacrer plus d’injustice que de justesse. Aussi, convient-il de recenser les principales voies ouvertes à ces procédures, et de vérifier si elles couvrent en toutes hypothèses les délits non intentionnels. Nous allons le faire en suivant l’articulation du code de procédure pénale relative au jugement des délits, ce qui nous renvoie au juge unique, à l’ordonnance pénale, et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
1/ Le juge unique
Le tribunal correctionnel est en principe composé d’un président et de deux juges. Énoncée à l’article 398 du code de procédure pénale, cette règle est cependant écartée pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, auquel cas, depuis la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le tribunal est composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. La dérogation est importante, d’abord qui libère une disponibilité bien utile, ensuite qui concède à la facilité de résolution des affaires les plus simples. C’est d’ailleurs en ces termes que s’articulent les dispositions de l’article 398-1, la liste des délits ouverts au juge unique l’étant par référence à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, sans tenir compte des aggravations résultant de l’état de récidive ou de circonstances plus ponctuelles liées au racisme (c. pén., art. 132-76), au sexisme (c. pén., art. 132-77) ou à l’utilisation d’un moyen de cryptologie (c. pén., art. 132-79), tout comme sont également concernés les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.
Ainsi posé, ce cadre de compétence à juge unique est parfaitement adapté aux homicides involontaires ou aux violences involontaires, du moins dans leurs versions les moins sévèrement sanctionnées. Mais c’est sans compter sur la liste des délits qui ressortissent à cette compétence. Ne sont visés, concernant les délits non intentionnels, que les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2, c’est-à-dire les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, ou celles d’une durée inférieure ou égale à trois mois, en lien avec la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ou l’agression commise par un chien, et, bien sûr, sans rien négliger du seuil maximal de cinq ans d’emprisonnement. C’est donc de manière très étroite que la matière est intégrée, qui ne comprend pas les homicides involontaires, quel qu’en soit le contexte, ainsi que tout ce qui procède d’une incapacité hors des hypothèses explicitement retenues, outre le fait que le tribunal statue obligatoirement en collégialité lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, ou encore lorsqu’il y a connexité à des délits non prévus dans la liste présidant au dispositif.
Cette concession stricte au juge unique est normale. Le dispositif procède de la commodité, et, nous l’avons souligné, d’une commodité qui n’a pas sa place pour des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, sauf à l’accepter en lien avec des figures moins vulnérables. La compétence retenue n’a d’ailleurs rien de définitif : le tribunal correctionnel siégeant à juge unique peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans sa formation complète (c. pr. pén., art. 398-2, al. 3). Tout est donc fait pour ne pas sombrer trop facilement dans ce qui pourrait être assimilé à une justice, non plus simplifiée, mais simplificatrice… Les contentieux en lien avec les élus locaux ne peuvent qu’y gagner, toujours sur la considération de ce qu’ils représentent de particulièrement sensibles : l’autorité publique est en cause, et la voie du juge unique n’est pas la meilleure pour se prononcer sur ses défaillances, tout comme c’est le cas du recours à l’ordonnance pénale.
2/ L’ordonnance pénale
En application de l’article 495 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, opérationnelle depuis la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à 5 000 €, et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. Le ministère public communique alors au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions, et le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Il s’agit là de la « procédure simplifiée » stricto sensu, parce que légalement qualifiée comme telle, et dont la raison d’être est de faire l’économie d’une procédure complète, sur des critères d’évidence quant aux charges pesant sur la personne poursuivie, ainsi que de faible gravité des faits à juger, ce qui justifie l’absence de débat contradictoire et qu’aucune peine d’emprisonnement puisse être prononcée.
L’allègement est important, qui témoigne d’une réelle spécificité de jugement, à la hauteur d’une réduction, sinon de justice, du moins du processus judiciaire concerné.
Bien évidemment, par son caractère dérogatoire, cette procédure d’ordonnance pénale n’est pas d’application générale. Elle est réservée aux délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, « à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ». Autrement dit, la matière se greffe sur le domaine déjà couvert par la procédure à juge unique, mais avec la précision qu’en est exclu tout ce qui participe d’une atteinte physique ou psychique à la personne. La liste des délits est bien celle figurant à l’article 398-1, mais amputée des infractions non intentionnelles qui y figurent, pour éliminer, sans distinction, toutes les qualifications d’homicides involontaires et de violences involontaires.
On ne peut qu’approuver, tant, même sans aller jusqu’à la mort, ce qui participe d’atteintes à l’intégrité des personnes mérite un minimum de contradiction. Il est une grande différence avec le juge unique, qui ne tranche pas sans débat, et donc sans la confrontation inhérente aux droits de la défense. L’ordonnance pénale n’intègre pas cette phase essentielle du procès, de sorte que les atteintes à la personne ne peuvent que lui échapper, avec pour conséquence d’exclure de son domaine la responsabilité des élus locaux pour délits non intentionnels.
3/ La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Dite « plaider coupable », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité remonte à la loi no 2004-204 du 9 mars 2004. Elle s’inscrit, elle aussi, dans la politique de simplification qui nous retient, son principe consistant à favoriser la reconnaissance des faits par la personne soumise aux poursuites, suivie de l’acceptation de la peine proposée par le procureur de la République, le tout relevant ensuite d’une procédure d’homologation entrant dans la compétence du président du tribunal judiciaire. Les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale en contiennent le régime, et, là encore, il s’agit de savoir si les délits non intentionnels sont concernés et dans quelles conditions.
La réponse est très claire. Elle est d’abord le fait de l’article 495-16, qui précise que : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques ». L’homicide involontaire est donc exclu du dispositif, comme il l’est de toutes les autres procédures rapides ou simplifiées dont nous avons fait état. Quant aux violences involontaires, elles sont également exclues, en application de l’article 495-7, mais seulement lorsqu’elles sont punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans. Autrement dit, les violences involontaires restent tributaires de la procédure du « plaider coupable » en dessous de ce seuil, ce qui revient à dire qu’elles le sont pour la plupart, tant sont peu en nombre les hypothèses affectées de peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement (c. pén., art. 222-19-1 et art. 222-19-2). Ce partage de la matière sur le critère de la sanction est un juste compromis : les délits non intentionnels représentent un important contentieux pour les juridictions correctionnelles, et il est normal de ne pas se priver de modalités permettant de l’alléger, l’essentiel tenant à la présence d’un magistrat du siège pour se prononcer sur la responsabilité et la peine. De portée générale, l’observation vaut naturellement pour les élus locaux, même si leur situation pourrait laisser penser que toute version consensuelle des poursuites pénales est difficilement compatible avec l’engagement d’une fonction ou d’une mission publique.
Notre conclusion se veut dans le prolongement de cette dernière remarque. L’efficacité et la rapidité de la réponse pénale passent par des règles dérogatoires, mais qui ne sont pas d’une application générale aux délits non intentionnels, la matière relevant d’une casuistique témoignant de ce qu’elle engage d’intérêts fondés sur la personne elle-même. Le droit pénal territorial, pour sa part, ne fait que les suivre, tout en profitant d’un retour fréquent au droit commun. Mais on peut se demander s’il ne devrait pas y rester par principe, tant les modèles de justice alternative ou simplifiée cadrent mal avec ce que l’exercice d’une autorité publique ou d’un service public suppose d’appréciation judiciaire sans concession, c’est-à-dire diminuée d’une part de justice attendue, au nom d’une efficience escomptée.