
Action sociale & solidarité
- Ces élus qui s’impliquent, Frédéric VILLE
- Communicabilité des documents de l’aide sociale à l’enfance face au secret de l’instruction : impact sur la suspension et le retrait de l’agrément des assistants maternels et familiaux, Émilie COLLIN
Au découvrir notamment ce mois-ci :
💸obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse (maire et ancien maire)
📹utilisation détournée d’images de vidéoprotection (adjoint)
🛒détournement de fonds publics pour des achats persos (employée municipale)… https://t.co/8pkQrqjr28
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 19, 2024

Associations
- Les flux à titre gratuit entre associations déclarées, Claire ANNEREAU et Simon CHAPUIS-BREYTON
- Transfert d’activité : faute d’employabilité, le licenciement s’impose
- La loi Séparatisme doit encore prouver son utilité effective, Thomas GIRAUD
📖 JURISASSOCIATIONS, n°696, 1er avril 2024, p.6
-
Cette proposition de loi qui veut faciliter l’engagement associatif, Mathilde THÉNOZ
- Le préfet, les manifestations pour la paix au Proche-Orient et l’ordre public "immatériel", Camille DOLMAINE
📖 JURISASSOCIATIONS, n°697, 15 avril 2024, p.33
- Mise à disposition d’un local communal à une association pour l’exercice d’un culte, Xavier DELPECH
📖 JURISASSOCIATIONS, n°697, 15 avril 2024, p.11
-
Obligation pour les associations subventionnées de participer aux cérémonies commémoratives, Cécile CHASSEFEIRE ET Adeline BEAUMUNIER
📖 ASSOCIATIONS MODE D’EMPLOI, 25 avril 2024
- La loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative est publiée
- Une loi pour simplifier la vie des associations vient d’être publiée - Lucile BONNIN
40,57 % des #élus poursuivis pénalement le sont pour manquements au devoir de probité. C’est donc le 1er motif d’exposition des élus !
Le dernier RA de @ObsSmacl accompagne les élus dans leurs actions. C’est bien là l’ADN de notre #mutuelle depuis 50 ans. Pour en savoir plus :… pic.twitter.com/iHtSytwcYe— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) April 19, 2024

Assurances, catastrophes naturelles & prévention des risques
- Recul du trait de côte : 500 communes identifiées comme particulièrement menacées - Aurélien WALTI
- Un nouveau rapport mise sur la prévention et la mutualisation pour assurer les risques climatiques - Emmanuelle TRECOLLE et Franck LEMARC
- Assurances : ce que préconise la commission des finances du Sénat, Mathilde ELIE
-
Assurabilité des collectivités : le Sénat pour porte-voix des élus - Mehdi ELAOUNI
- Mieux cerner l’assurance dommages-ouvrages, Sophie BANEL & Elise CHAPEL
- Établir l’inventaire des propriétés immobilières des collectivités territoriales - Timothée DUMORTIER
- Quelles solutions d’assurance aux collectivités territoriales ? - Fabrice RIBET
- Certitudes et incertitudes, Claude LIENHARD
📖 JOURNAL DES ACCIDENTS ET DES CATASTROPHES, 26 avril 2024
- Urgence de renforcer la lutte contre l’amiante dans les écoles, Isabelle CORPART
- Gemapi et responsabilité administrative : le cas des cours d’eaux non domaniaux -Raphaël MEYER
-
Assurances : une entente public-privé est indispensable, Laurent ROUSSEAU
- La taxe Gemapi, véhicule de financement de la compétence éponyme - David YTIER
- Gemapi et intercommunalités - Oriane CEBILE
- Bilan des modes de gestion de la compétence Gemapi - Morgane LETANOUX
- Prévention des inondations : le cas du transfert des digues domaniales - Morgane LETANOUX
- Mise en œuvre opérationnelle de la compétence Gemapi : déclaration de projet de travaux et autorisation environnementale - Rémi BONNEFONT
- Catastrophes climatiques : la Croix-Rouge alerte sur le besoin impérieux de mieux se préparer localement - Lucile BONNIN
Les épisodes de sécheresse s’intensifient et le phénomène Retrait-gonflement des sols en argile #RGA prend de l’ampleur sur nos territoires. Rendez-vous dans le dernier numéro du #SMACLInfos pour démêler le vrai du faux 👉 https://t.co/DZYL4Nk2yZ pic.twitter.com/dUY4RXQfdx
— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) April 17, 2024

Construction
- Six mois de droit de la construction. Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de cassation au second semestre 2023, Laurent Karila
- Nouveau renforcement de l’obligation de conseil des maîtres d’œuvre, Hélène HOEPFFNER
- Mieux cerner l’assurance dommages-ouvrage, Sophie BANEL
⚡ Nouvelle illustration de la difficulté pour les communes d’invoquer la force majeure en cas d’évènement climatique d’une particulière intensité (ici un orage particulièrement violent)
👉https://t.co/f7ScxekyEb pic.twitter.com/RZqv6sce2r
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 5, 2024
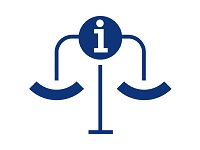
Contentieux & procédures
-
Contentieux administratif : panorama de jurisprudence (janv.-juin 2023) Questions de procédure : introduction de l’instance - Marie-Christine ROUAULT
-
Contentieux des « crèches de Noël » : le référé-suspension est une voie plus restrictive que le référé mesures utiles, Farid BELACEL
-
Les moyens d’ordre public - Fabrice MELLERAY
📖 AJDA 2024 p.787
- Chronique de droit des modes alternatifs de règlement des différends . - Textes et décisions du 2nd semestre 2023 - Mehdi LAHOUAZI
- La place des recours amiables en droit public - Rhita BOUSTA
- Les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes au filtre du procès administratif - Ahmed SLIMANI
- Un acte pris sur injonction du juge reste un acte attaquable - Eric LANDOT
🧐Un élu condamné pour prise illégale d’intérêts et pour harcèlement moral peut-il obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ?
⚖ La réponse du TA d’Amiens
👉 https://t.co/P7jm4ABhMD pic.twitter.com/lDGxvI6SwG
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 12, 2024

Contrats et marchés publics
- Unification du contentieux des marchés publics : la fin des marchés publics de droit privé ? - Mathieu LAUGIER
-
Ordre public et contrats administratifs - Ferdi YOUTAEn observant l’intervention de l’ordre public dans le champ particulier des contrats administratifs, et en regardant ces mêmes contrats à travers l’ordre public contractuel, l’idée qui prédomine est celle d’un enrichissement mutuel. Si la notion d’ordre public dans le champ des contrats administratifs reste difficile à saisir, elle demeure cependant unitaire, à rebours de la fragmentation qu’elle connaît en droit privé des contrats. L’ordre public contractuel rend les contrats administratifs plus contractuels... mais aussi plus administratifs.
📖 AJDA 2024 p.781
-
L’ « urgence » dans les marchés publics : un concept théorique en référé-suspension - Mathieu LAUGIER
- La Cour de cassation peaufine le cadre juridique de la sous traitance, Karen VIEIRA
- Traiter les conflits d’intérêts lors de la passation des contrats de la commande publique, Bastien DAVID
-
Déclarations URSSAF et marchés publics, un nouveau risque pour la commande publique, Florian LINDITCH
- Le gouvernement cible les retards de paiement dans les commandes, Gabriel ZIGNANI
- De la problématique de l’offre incomplète, Eric LANZARONE
- AMO et conflit d’intérêts : une interprétation extensive en marché public ! - Mathieu LAUGIER & Aurélien BUREL
- Au plus près des TA Tu ne dénatureras point ! Un commandement sacré dans la commande publique, Nicolas LAFAY
📖 ACHATPUBLIC.INFO, 11 avril 2024
-
L’ « urgence » dans les marchés publics : un concept aux multiples vertus, Mathieu LAUGIER
📖 ACHATPUBLIC.INFO, 12 avril 2024
- De l’intérêt de recourir au contrat de concession, Vanessa PARDO LEBON
- Exclure le candidat ou amputer la procédure : le Conseil d’État a tranché - Yanisse BENRAHOU
L’exclusion prévue à l’article L. 3123-1 et suivants du Code de la commande publique est obligatoire dès lors que l’autorité concédante constate que les faits qui la justifient sont avérés. Cela semble mériter la mise en place d’une procédure de traitement des incidents mentionnés au titre des exclusions à l’appréciation de l’autorité concédante ou de l’acheteur public. Les entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs devraient trouver, dans les différentes procédures d’enquête interne qui voient le jour, une source d’inspiration pour organiser la traçabilité des vérifications effectuées après l’incident.
- Passation d’un contrat de concession : quelles conséquences en cas de divulgation d’informations confidentielles ? Jean-David DREYFUS

Cybersécurité & RGPD
- Des collectivités trop friables face au risque cyber croissant, Aurélien Hélias
🗞️Les #CollTerr améliorent leur niveau de #cybersécurité. Découvrez comment la ville de @CastelnauleLez a sécurisé ses données dans #SMACLInfos👉https://t.co/XJHobw7Lbr #TousRésilients #ÀVosCôtés, nous vous recommandons les bonnes pratiques afin de limiter les #cyberattaques pic.twitter.com/CvxXmneXYm
— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) April 12, 2024

Domaine
- Incompétence du juge administratif des référés pour prescrire l’expulsion d’un club sportif occupant un immeuble communal manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public, Philippe YOLKA
- Qui est compétent pour décider de conclure une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public communal ?, Karin CIAVALDINI
-
Occupation sans titre du domaine public : prescription de l’action en réparation, Lucienne ERSTEIN
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, act. 225
-
Appropriation par les communes de biens sans maître : étendue de la compétence du juge administratif - Romain VICTOR
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, 2111
- Le point sur... la définition du domaine public routier - David BLONDEL, Christophe MONDOU
- Cinéma : quel mode de gestion choisir ? - Eric LANDOT
- Les garanties d’usage dans les ports de plaisance : les opposants touchés-coulés - Eric LANZARONNE

Elections & démocratie locale
-
Dépôt de compte de campagne et inéligibilité : les retardataires ont toujours tort (ou presque), Léa ZAOUI
- Élections européennes : tout savoir sur le scrutin - Franck LEMARC et Xavier BRIVET
-
Le droit de pétition permet de demander, et non d’obtenir, l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, Manon VAN DAELE
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, act. 229

Environnement & énergie
- Tout savoir sur les communautés d’énergie, Nathalie QUIBLIER
- Vers l’arrêt des vols intérieurs courts ? Marion TERRAUX, Anna VERAN
- Le principe de non-régression et la loi - Jean-Sébastien BODA
- Extension au 1er février 2025 des tarifs réglementés de vente d’électricité à l’ensemble des petites communes et des TPE
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, act. 222
🔥Prévention des feux de forêts : des OLD renforcées
Trois textes réglementaires publiés fin mars 2024 détaillent les modalités de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Tour d’horizon des principales nouveautés.
👉https://t.co/coPWHi10wI pic.twitter.com/yRpRjwbqxL
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 17, 2024

Finances publiques
- LFSS 2024 : tour d’horizon des mesures concernant les collectivités, Juliette VIELH
-
Rapport d’observations d’une CRC sur la gestion d’une collectivité : rappel et précisions sur le contrôle du juge, Claire DEMUNCK

Fonction publique
-
Projet de loi pour l’efficacité de la fonction publique... filtrer le moustique mais refuser de regarder le chameau ? - Hélène PAULIAT
- Substitution d’une communauté d’agglomération à un syndicat intercommunal : un transfert sans restriction de l’ensemble des personnels - Hélène PAULIAT
-
Droit de la fonction publique et contentieux contractuel : l’arrêt Ville de Lisieux ne meurt jamais ! Hadi HABCHI
- Du nouveau dans la promotion interne, Jennifer RIFFARD
- Comment communiquer le dossier de l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’il comporte des témoignages ?, Dorothée PRADINES
- Qui supporte les conséquences de l’irrégularité des modalités de reprise d’un agent affecté à une activité transférée par une CCI ?, Marc Pichon DE VENDEUIL
-
Comment évaluer le préjudice financier subi par un agent irrégulièrement révoqué ? Hélène PAULIAT
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 15, 15 avril 2024, 2107
- Concilier organisation du travail des agents et JO 2024, Nathalie KACZMARCZYK
-
Chronique de contentieux du doit de la fonction publique et des ressources humaines, Samuel DELIANCOURT & et Aurélie VIROT-LANDAIS
Le premier semestre 2023 a été riche en actualités normatives, principalement jurisprudentielles. Dans cette première partie de la chronique janvier-juillet 2023, sont tout particulièrement prégnantes les questions relatives à la durée du temps de travail, aux positions statutaires ainsi qu’aux garanties accordées aux agents publics.📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, 2110
-
Chronique de contentieux du doit de la fonction publique et des ressources humaines, Samuel DELIANCOURT & et Aurélie VIROT-LANDAIS
- La protection fonctionnelle des agents publics et des élus, Julia DEGUERRY LECETRE
- Le paiement des indemnités journalières aux anciens fonctionnaires territoriaux, Christophe SOVET
- Protection des agents. Le rôle de l’employeur public, Fabienne NEDEY
-
Le juge annule le licenciement d’une fonctionnaire qui s’était “autopromue”, Bastien SCORDIA📖 ACTEURS PUBLICS, 30 avril 2024
-
Les fonctionnaires ne peuvent invoquer des données de l’Insee pour contester le montant de leur salaire - Bastien SCORDIA
La cour administrative d’appel de Douai vient de rejeter la requête d’une fonctionnaire territoriale concernant le montant de sa rémunération, qu’elle jugeait trop faible. Pour contester ce montant, elle se référait au salaire mensuel moyen calculé par l’Insee pour l’ensemble des corps de sa catégorie hiérarchique. Des données non représentatives, font valoir les juges.📖 ACTEURS PUBLICS, 3 avril 2024
-
Fonctionnaires : la rupture conventionnelle peut être refusée faute d’effectifs, Bastien SCORDIA
- Refus du bénéfice de l’allocation-chômage pour les fonctionnaires territoriaux de retour de détachement - Julien BEAL-LONG
- L’aménagement de poste dans la fonction publique - Didier JEAN-PIERRE
- Lancer une alerte ou régler publiquement ses comptes ? - Laurent DERBOULLES
📖 AJFP 2024 p.286
- La décision d’un employeur public d’interdire, au nom d’une politique de neutralité, le port de signes religieux à ses employés sur leur lieu de travail est conforme au droit de l’Union - Charles FROGER
📖 AJFP 2024 p.292
- La protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux - Caroline LETELLIER & Kamel BOULACHEB
En effet, jusqu’à présent, les employeurs publics pouvaient contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de frais de santé et/ou de prévoyance auxquelles leurs agents souscrivaient : la participation financière des employeurs publics revêtait ainsi un caractère purement facultatif. Avec la réforme, dans la fonction publique territoriale, les employeurs publics vont avoir l’obligation de participer au financement des garanties frais de santé et de prévoyance de leurs agents, dans un cadre juridique précis et novateur.
En outre, il sera possible d’imposer aux agents de souscrire à des garanties frais de santé et prévoyance, là encore dans le respect des règles fixées par les textes.
La réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale en 50 questions-réponses.

Intercommunalité
-
Substitution d’une communauté d’agglomération à un syndicat intercommunal : un transfert sans restriction de l’ensemble des personnels, Hélène PAULIAT
-
Gemapi et intercommunalités, questions...à Oriane Cébile
-
Un EPCI assume toutes les obligations nées avant le transfert de compétences, Philippe BLUTEAU
📖 AJ COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, avril 2024, p.251

Logement
- Ce que contient la loi sur la rénovation de l’habitat dégradé - Franck LEMARC

Normes & simplification
- Normes : un « changement de mentalité » à opérer - Bénédicte RALLU
Le Rapport Annuel de l’@ObsSmacl est disponible !
Cet outil est d’une grande utilité pour les #élus, fournissant des données statistiques précieuses et des résumés de #jurisprudence.
Il permet de mieux identifier les risques juridiques pour une #prévention efficace. Pour une… pic.twitter.com/WqiEtUZMXB— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) April 2, 2024

Pouvoirs de police
- Travaux dans un cimetière : quelles obligations pour le maire ?, Antoine CARLE
-
Dépôts sauvages : le maire, avec l’aval d’un juge, peut vérifier l’enlèvement sur une parcelle privée, Fabienne NEDEY
-
La mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance algorithmique au sein de l’espace public par une collectivité condamnée, Hélène ADDA
- La commune et la publicité, GD MARILLIA
- Police administrative et ordre public : les notions plastiques, est-ce si fantastique ? Olivier RENAUDIE
📖 AJDA 2024 p.774
-
Préparation des stationnements des grands groupes de gens du voyage : publication de la circulaire pour 2024
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 14, 8 avril 2024, act. 195
🔥🏚🚒Incendie non maîtrisé : la commune peut-elle être déclarée responsable en cas d’insuffisance du débit des bornes incendie et de l’absence de recensement d’une piscine comme source alternative d’approvisionnement en eau ?
📢La réponse de la CAA de Bordeaux (merci @JCPA1 🙏)… pic.twitter.com/XzP0q6LSAI
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 19, 2024

Responsabilité, compliance & transparence de la vie publique
- Impartialité affirmée, malgré les apparences, de la juridiction administrative - Mathieu TOUZEIL-DIVINA
- Chronique de déontologie de la vie publique locale . - Actualités de juillet à décembre 2023 - Elise UNTERMAIER-KERLEO, Pierre VILLENEUVE, Luc BRUNET
- Violences sexistes et sexuelles dans les collectivités territoriales : quelles réponses juridiques ? - Olivier DIDRICHE, MATHILDE SALMON
-
Opportunité des poursuites par le procureur financier : du mythe à la réalité. Au lendemain de la réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics - Gildas Le BRISLe monopole des poursuites est une prérogative du procureur financier, mais quid de l’opportunité de son action ? Dans la pratique, il s’est arrogé cette compétence en l’absence de disposition explicite en ce sens. Un nouveau fondement juridique accrédite dorénavant cette évolution, vers une finalité ciblée des poursuites.📖 AJ COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, avril 2024, p.234
- Anticorruption : la France ne se conforme pas suffisamment aux recommandations du GRECO – Maud LENA
- Le conflit d’intérêts, c’est un sujet (aussi) en DSP - Etienne DUCLUSEAU
🙋♀️Référent déontologue : suites et pas fin...
❌ Dans une réponse ministérielle publiée le 23 avril 2024, la #DGCL souligne qu’un élu "ne peut pas saisir le référent déontologue de la situation d’un autre élu" (merci Maxime JULIENNE du signalement de cette réponse).
✅Une… pic.twitter.com/OlP0Ulnx6C
— Observatoire Smacl (@ObsSmacl) April 30, 2024

Statut de l’élu
-
Loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux : premiers éléments de débat - Samuel DYENS
-
Dotation « élu local » : un décret officialise le versement à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants - Aurélien WALTI
- A la fois maire et employé municipal, Sandrine ARRAULT
-
Sécurité des élus locaux et protection des maires : la loi est publiée
-
L’extension de la protection fonctionnelle aux élus locaux qui ne bénéficient pas d’une délégation de fonction ou de signature de l’exécutif
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, 2112
- Maires et élus locaux. Renforcement de la sécurité et de la protection
-
Le renforcement confus de la sécurité et de la protection des élus locaux par la loi du 21 mars 2024, Rodolphe MESA
Place aux #Actes ! La hausse des agressions contre les #élus, comme l’augmentation des mises en cause ne sont pas de nature à encourager les vocations et le dévouement au service de la chose publique et du bien commun.
Comment élaborer des stratégies de #prévention efficaces ?… pic.twitter.com/nmalKR5mmY
— Smacl Assurances (@SmaclAssurances) April 9, 2024

Urbanisme
- Diviser pour mieux construire, Félix AVENEL
📖 LE MONITEUR, 5 avril 2024, p.74
-
Délai de prescription des taxes attachées à un permis de construire transféré, Lucienne ERSTEIN
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 14, 8 avril 2024, act. 193
-
Effets de l’illégalité du document d’urbanisme : la vision du juge de cassation, Lucienne ERSTEIN
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 15, 15 avril 2024, act. 207
-
Chronique de jurisprudence en droit de l’urbanisme . - Décisions du Conseil d’État de mai à décembre 2023 - Julien MARTIN et Francis POLIZZI
Plusieurs décisions intéressantes ont été rendues au cours de la période. La plus importante, attendue, concerne la possibilité d’assortir le PLU d’un « cahier de recommandations architecturales », et, plus largement, les chartes promoteurs. Le Conseil d’État a par ailleurs refusé que la seule évolution favorable des règles vaille régularisation après sursis à statuer. Enfin, une décision lue en décembre dernier fixe le régime des modifications en cours d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 15, 15 avril 2024, act. 207 -
Une autorisation d’urbanisme frauduleuse ne peut pas être régularisée devant le juge, Francis POLIZZI
📖 LA SEMAINE JURIDIQUE ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES n° 16, 22 avril 2024, 2116
-
Le juge ne peut subordonner la régularisation d’une autorisation d’urbanisme à l’absence de modification du projet, Francis POLIZZI
- Dans quelles conditions l’autorité administrative saisie d’un projet illégal doit-elle délivrer un permis assorti de prescriptions plutôt que d’opposer un refus ?, Victor POUGET VITALE
- La prescription spécial assortissant le permis de construire comme alternative au refus : proposition d’un mode d’emploi, Mickaël REVERT
📖 RDI, n°4, avril 2024, p.234
- Loi "reconstruction" : les députés souhaitent pérenniser le dispositif, Mathilde ELIE
- Quinze ans après, un nouvel avatar des malfaçons de la LME, Jean André FRESNEAU
- Etre indemnisé si t’es exproprié ? Dans tes rêves si t’as construit illégalement, Amélie DADON
